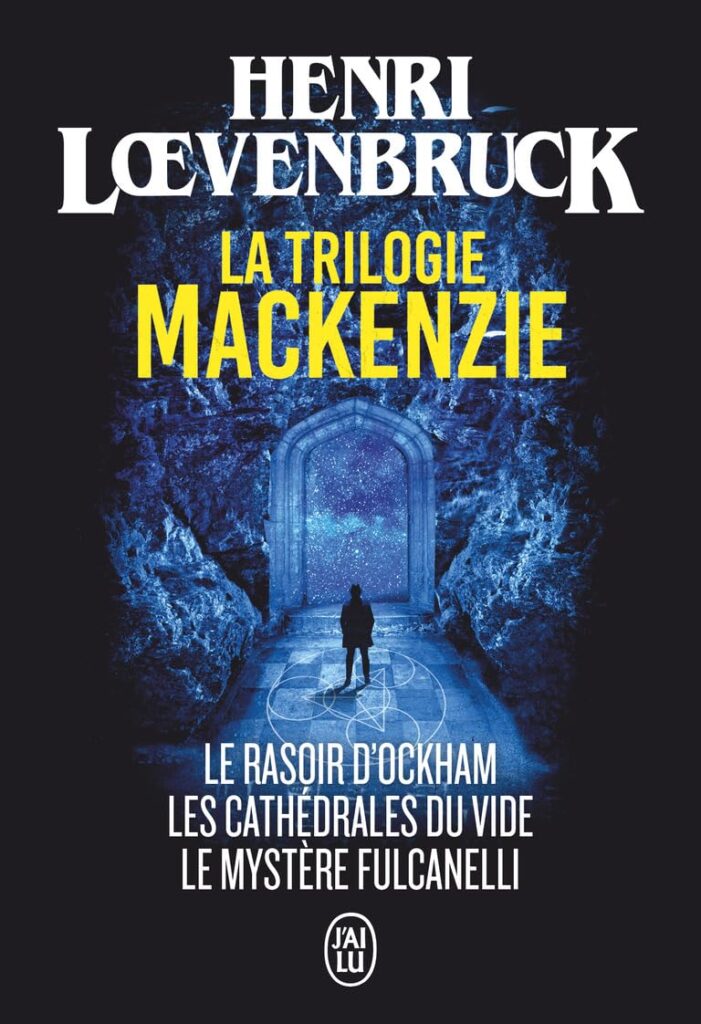Vous le savez peut-être : il y a une quinzaine d’années, j’ai eu le plaisir d’aider mon vieux pote Renaud sur un projet un peu fou et profondément touchant : un album hommage aux ballades irlandaises. J’ai traduit une vingtaine de classiques pour lui, en y glissant quelques suggestions d’adaptation. Fichtre, j’ai même fini par chanter sur l’album. Enfin… chanter est un bien grand mot. Un jour, alors que je donnais un petit concert, Renaud, venu me voir, m’a retrouvé dans les loges et m’a lâché, hilare :
— La vache ! Tu chantes tellement mal que tu pourrais faire les chœurs sur mon disque !
Dont acte.
Allez, petite anecdote croustillante sur l’enregistrement.
Nous sommes chez Renaud, à Meudon, dans sa cave transformée en studio artisanal par l’ingénieux Cyril “Reptile” Noton. À la console, son papa, le regretté Thomas Noton, tendre et talentueux réalisateur de l’album (fucking miss you, matey). Avec nous, deux musiciens de haut vol : Ramon Pipin (Odeurs, entre autres joyeusetés) et Laurent de Gaspéris (Treponem Pal, pour ne citer que ça), venus poser leurs voix sur les chœurs à mes côtés.
Il est 14h. Renaud, fidèle à sa routine, fait sa sieste. Le studio est à nous. Reptile branche les micros, me demande un test. Je me mets en place, et évidemment, pour faire marrer la galerie, je commence à chanter… en imitant la voix de Renaud. Faut dire que je suis assez connu pour ma caricature, une imitation bien gratinée. Si vous êtes sages je vous la ferai dans un quart d’heure rosé…
Je me lance, le casque sur les oreilles, et mes compères de l’autre côté de la vitre se bidonnent. Moi, dès qu’on rit, j’en remets une couche, comme un gosse. Je m’emballe, j’en fais des tonnes. Sauf que soudain, plus un rire. Le silence. De l’autre côté de la vitre, tous les regards sont baissés. Malaise.
Je retire lentement le casque.
Je me retourne.
Renaud est là. Juste derrière moi.
Il a tout entendu.
— Euh… Ça va, frangin ? Bien dormi ?
— Connard !
C’était… chouette.
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’un jour, Renaud m’a proposé un défi inverse : traduire ses propres chansons en anglais. Et là, je vous jure, c’est sans doute le boulot le plus complexe que j’aie eu à faire de ma vie. Rendre la poésie brute, les jeux de mots, la tendresse vacharde de Renaud en anglais… un vrai casse-tête. Je ne sais pas s’il en fera quelque chose un jour, il a un peu laissé ça de côté, mais juste pour le fun, je vous en partage un extrait. Saurez-vous reconnaître la chanson à partir de ce premier couplet traduit ?
She hung on the wall,
Near the baby’s cot,
A picture of Wal…
Ter Scott.
She says he’s so hot
With his silky scarf
In the kid’s room what
A laugh !
The angel design
She drew on the wall
Was not a good sign
At all !
Our flat’s like a bin
(She’s making a flub)
Since my baby’s in
The club !